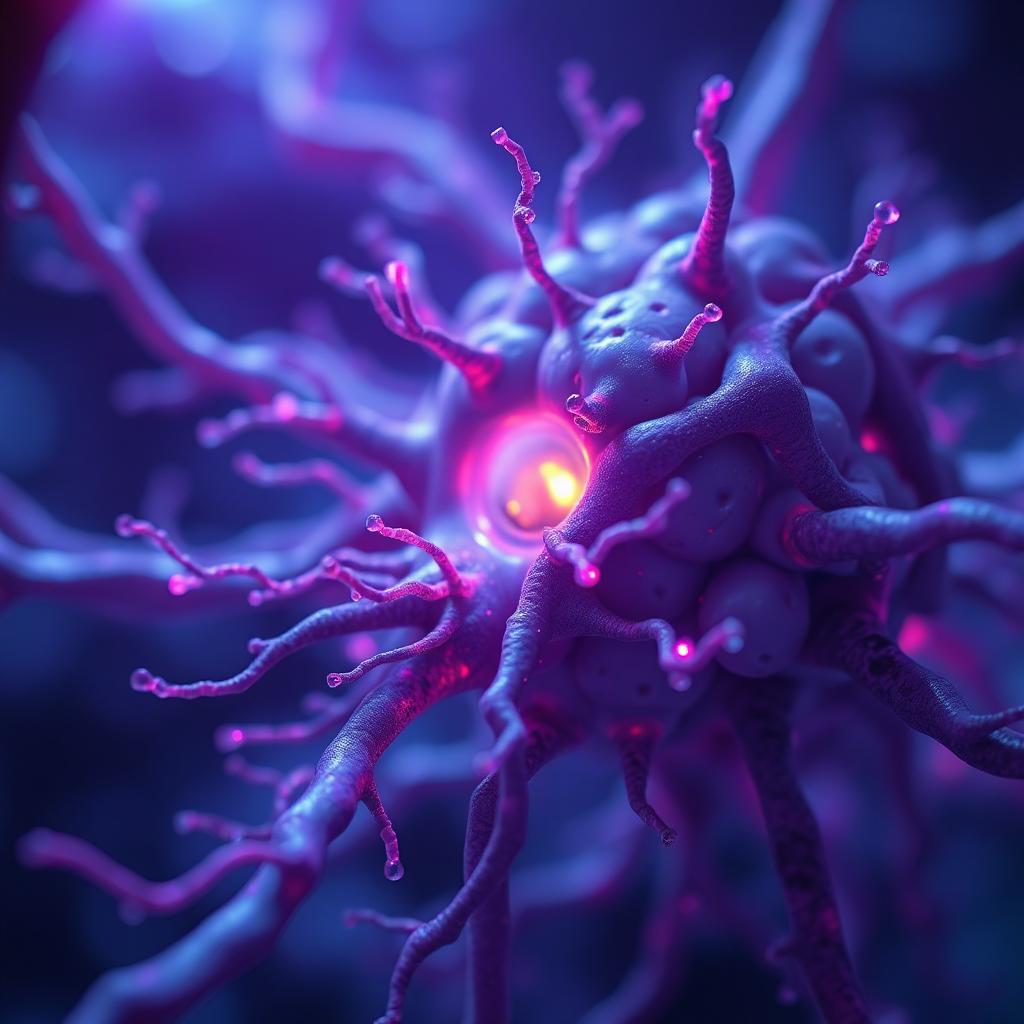Pourquoi l’humain est-il si vulnérable au #risque de #dépression ?
Gilles Bertschy, Université de Strasbourg
La dépression se traduit par de la tristesse, une perte d’intérêt ou de plaisir, et une perte d’énergie. À cette triade s’associent des symptômes physiques – comme un ralentissement psychomoteur, des troubles de l’appétit et du sommeil – mais aussi psychologiques – avec des difficultés de concentration et des pensées négatives – le tout pouvant conduire au suicide. Enfin, des symptômes non spécifiques de la dépression – à l’instar de l’anxiété et des douleurs – peuvent compléter le tableau. Et la quasi-permanence et la sévérité de tous ces signes doivent avoir un retentissement significatif sur le fonctionnement personnel, pour que l’on parle de dépression caractérisée ou majeure nécessitant une intervention thérapeutique.
Une maladie très répandue
Ainsi définie, la dépression touche 15 à 20 % des humains au cours de leur vie, et la moitié d’entre eux fera plus d’un épisode. N’importe qui peut être concerné, mais de nombreux facteurs augmentent les risques : des antécédents familiaux de dépression, de troubles bipolaires et d’addictions (reflétant notamment une prédisposition génétique), des événements prédisposants de l’enfance (carences affectives, maltraitance, abus…), des événements déclencheurs survenus peu avant le début de l’épisode (souvent une perte, quelle que soit sa nature), une maladie physique (surtout si elle est grave, douloureuse ou touche le système nerveux central) ou encore d’autres troubles psychiatriques (quels qu’ils soient).
Autre constat, si la dépression frappe des personnes de tempérament et de personnalité variés, on l’observe plus souvent chez certains. Elle se révèle plus fréquente en cas d’instabilité émotionnelle et de fonctionnement chaotique (les personnalités borderline), ou bien chez les anxieux dépendants, les scrupuleux obsessionnels, les pessimistes, insatisfaits et fatigués au long cours, ou encore à l’opposé chez les hyperactifs, optimistes et extravertis.
En réalité, les mécanismes du processus dépressif sont très complexes. Leur nature est en effet psychologique et neurobiologique (avec des mécanismes bien plus élaborés qu’un simple manque de sérotonine), raison pour laquelle la dépression n’est pas une simple expérience humaine, mais une véritable maladie. Mais pourquoi l’homme est-il si vulnérable au risque de dépression ? La médecine évolutionniste nous apporte des éléments de réponse.
Cette médecine repose sur l’idée selon laquelle l’évolution, au sens darwinien du terme, a sélectionné des facteurs de vulnérabilité à certaines maladies s’avérant avantageux pour la survie de l’espèce. Par exemple, on pense que certains sont prédisposés au risque d’obésité dans notre société de surabondance alimentaire, parce que leurs ancêtres étaient confrontés à la disette : l’évolution aurait sélectionné les variantes génétiques permettant de faire rapidement d’importantes réserves de calories sous forme de masse graisseuse, quand nourriture il y avait. Or compte tenu de la prévalence élevée de la dépression, on peut imaginer que des caractéristiques la facilitant aient été retenues par la sélection naturelle, eu égard aux avantages qu’ils procuraient. Plusieurs hypothèses ont donc été proposées…
Se préserver et préserver les autres ?
Pour certains, la dépression serait une fonction adaptative d’autolimitation. Selon ce point de vue, un état dépressif permettrait à l’individu de ne pas mettre en péril ses ressources ou sa place dans le groupe social : dès les origines, l’être humain aurait ainsi pu échapper à la mort par épuisement, quand le creusement de son terrier butait sur de la roche, ou quand ses tentatives de promotion au sein d’un groupe devenaient risquées.
D’autres chercheurs voient dans la dépression un mécanisme de défense comportemental apparenté à ceux que les éthologues ont décrits chez les animaux : soumission, rupture de contact, immobilisation ou recherche d’aide. Mais ce qui est un avantage adaptatif (en limitant par exemple les possibilités d’agression par un congénère), peut aussi se révéler non adaptatif : quand les affects dépressifs permettent la soumission et donc l’apaisement de l’adversaire, ils favorisent aussi le rejet au sein du groupe social, ce qui peut nourrir le processus de dépression…
En remontant encore plus loin sur le plan phylogénétique, des chercheurs avancent l’idée de la sélection naturelle d’un programme de lutte contre les infections. Selon cette approche, il y aurait au départ un comportement protecteur de retrait et d’isolement – nous l’avons tous vécu quand la grippe nous cloue au lit. Une telle attitude limite les risques de gaspiller son énergie, de s’exposer à d’autres infections, de se mettre dans des conditions défavorables à la guérison, ou encore de contaminer des membres de son groupe. Mais elle pourrait parfois s’activer à mauvais escient, et générer une dépression.
À cette liste on doit ajouter les hypothèses qui se focalisent sur l’émergence, plus récente du point de vue de l’évolution, de certaines fonctions psychiques. Par exemple, la capacité à lire les états internes d’autrui. Elle a certainement procuré un avantage sélectif, en rendant chacun plus malin au sein de son groupe social. Mais elle a aussi donné accès à ses propres états internes douloureux, et ainsi ouvert la porte au ressenti dépressif et à la dépression.
La dépression, un effet secondaire ?
Selon une perspective différente, l’évolution aurait sélectionné la réactivité affective (ou sensibilité) qui favorise les liens et la solidarité dans un groupe social, et donc la survie en tant que groupe. Mais son niveau est variable selon les individus : certains ont ainsi une sensibilité exacerbée (ils sont facilement inquiets et touchés par ce qui se produit dans leur vie ou celle des autres), et donc un risque augmenté de dépression.
Autre hypothèse avancée : devenir capable de faire une chose et de penser à une autre aurait un avantage évolutif, mais aussi un coût émotionnel indirect favorisant la dépression. En clair, en n’étant pas focalisé sur ce que l’on fait, on aurait tendance à plonger dans un état émotionnel plus négatif. Mais à l’opposé, d’aucuns considèrent que c’est l’aptitude à se concentrer pour résoudre des problèmes qui, poussée à l’excès, pourrait favoriser ruminations et dépression. Une aptitude qu’aurait retenue la sélection naturelle, au détriment de la dispersion et de l’intérêt simultané pour plusieurs choses, dans le but d’économiser l’énergie dépensée par le cerveau.
Évoquons aussi l’idée selon laquelle dans l’environnement social très complexe qui est le nôtre, notre cerveau aurait tendance à minimiser les incertitudes et à identifier systématiquement le risque d’interrelations négatives – par exemple, le risque d’être rejeté par ses pairs. Or un tel fonctionnement exposerait au risque de précautions inutiles favorisant la dépression, dans une logique de prophétie autoréalisatrice.
« La sélection n’est pas manichéenne »
On le voit, la liste est longue. D’aucuns se sont même risqués à une hypothèse plutôt hardie, pour expliquer la prévalence plus élevée de la dépression chez les femmes. Il a en effet été noté que dans des situations de conflit ou d’insatisfaction relationnelle, la réaction semble dépendre de la force musculaire du haut du corps : quand une personne a beaucoup de force, elle sera facilement en colère, et si elle en a peu, elle penchera plutôt vers des sentiments dépressifs. Or ces corrélations sont indépendantes du genre. Mais les femmes ayant en moyenne moins de force dans les membres supérieurs que les hommes, des chercheurs en concluent qu’elles sont plus exposées à des sentiments dépressifs et partant, à la dépression.
Bien entendu, toutes ces hypothèses pèchent par leur simplicité. Mais elles ont le mérite d’être variées et complémentaires, ne s’excluant pas mutuellement. Et elles nous poussent à réfléchir sur les programmes ou fonctions qu’héberge notre cerveau, et qui, hérités de nos ancêtres, participent de notre vulnérabilité d’humain face à la dépression. Si ces programmes ou fonctions ont été retenus par la sélection naturelle, c’est en effet parce qu’ils offraient d’indéniables avantages. Car comme l’a écrit voilà bientôt vingt ans le psychologue britannique Paul Gilbert, « la sélection n’est pas manichéenne ».![]()
Gilles Bertschy, Professeur des universités – Praticien hospitalier, Université de Strasbourg
Cet article est republié à partir de The Conversation sous licence Creative Commons. Lire l’article original.