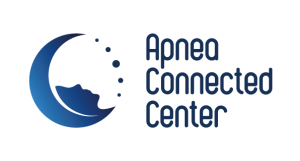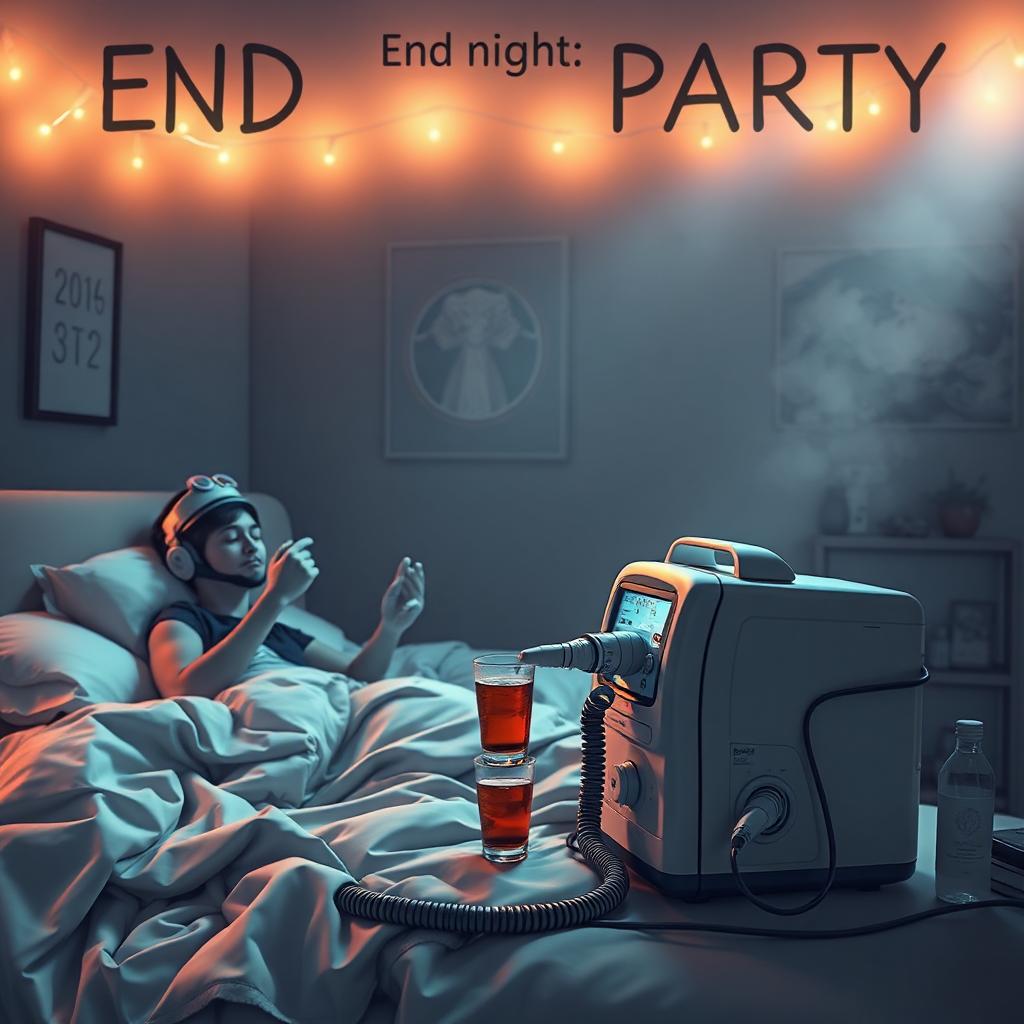#Apnée 3.0 : L’#IRM et la #Pathogenèse précoce de la #Maladie d’#Alzheimer (MA)
Une étude prospective utilise une approche induite par neuroimagerie multimodale afin d’analyser l’impact neurobiologique potentiel de l’apnée obstructive du sommeil (AOS) sur la pathogenèse précoce de la maladie d’Alzheimer (MA) chez une cohorte de sujets âgés cognitivement normaux, issus de l’essai clinico-épidémiologique Age-Well.
L’évaluation complète comporte une polysomnographie, une IRM volumétrique pour mesurer le volume de substance grise, une tomographie par émission de positons (TEP) avec 18F-florbetapir pour quantifier la charge amyloïde (Aβ), ainsi qu’une sous-cohorte avec TEP 18F-fluorodéoxyglucose (FDG) pour évaluer le métabolisme cérébral.
L’analyse polysomnographique définit un index d’apnées-hypopnées (IAH), et conserve deux groupes distinctionnels : patients avec IAH < 15 events/h (n=31, négatifs) versus ceux avec IAH ≥ 15 events/h (n=96, positifs).
Les covariables contrôlées comprennent l’âge, le sexe, l’éducation, l’indice de masse corporelle (IMC), la prise de médicaments pouvant influencer le sommeil, et le statut pour l’allèle ε4 de l’APOE.
Les résultats montrent une augmentation significative du volume de substance grise dans le cortex cingulaire postérieur et le précunéus chez les sujets avec AOS, associée à une surcharge en dépôts amyloïdes mesurée par la tomographie avec 18F-florbetapir, en particulier dans ces régions.
Par ailleurs, la TEP FDG indique une hypermétabolisme locale concomitante, témoignant d’une hyperactivité neuronale probable, ce qui pourrait représenter une phase de réponse neuroinflammatoire ou de compensation neurofonctionnelle.
L’analyse de régression multivariée, par sélections pas-à-pas, met en évidence que la sévérité de l’épisode hypoxique, caractérisée par la durée cumulée des épisodes d’hypoxie (pO2 inférieur à un seuil hypoxique), la fréquence et la profondeur de ces épisodes, représente la variable prédictrice la plus robuste de la charge amyloïde accrue.
Ces données soutiennent un mécanisme physiopathologique où l’hypoxie intermittente favorise la production de peptides bêta-amyloïdes en stimulant la sécrétase β, ou en diminuant la clairance du débris amyloïde, processus déjà observé dans des modèles expérimentaux animaux.
Malgré ces observations, il n’existe pas de corrélation statistiquement significative entre l’augmentation de la charge amyloïde ou l’augmentation du volume de substance grise et des scores neuropsychologiques standards (mémoire verbale, fonctions exécutives, vitesse de traitement de l’information).
De même, aucune relation n’est mise en évidence avec des auto-évaluations de la qualité du sommeil ou de la somnolence diurne (échelle d’Epworth). Ces résultats indiquent que ces marqueurs neurobiologiques précoces précèdent probablement toute manifestation clinique ou subjective.
En résumé, ces données suggèrent que l’AOS, par le biais de l’hypoxie intermittente chronique, constitue un facteur de risque pouvant moduler la progression neuropathologique amyloïdogène, en particulier dans le cortex cingulaire postérieur et le précunéus, régions clés dans la connectivité cérébrale de la mémoire et de l’attention.
La co-occurrence de l’hyperactivité métabolique et neuronale pourrait refléter une réponse neuroinflammatoire ou un état de compensation neurofonctionnelle en réponse à des processus de neurotoxicité.
La survenue de ces modifications pourrait précéder l’émergence de déficits cognitifs ou de symptômes cliniques liés à la MA.
Les auteurs insistent sur la nécessité d’études longitudinales afin d’évaluer si la prise en charge efficace de l’AOS, notamment par ventilation en pression positive continue (CPAP), permettrait de réduire la surcharge amyloïde, de moduler l’inflammation neurogène, et de ralentir potentiellement la progression de la neurodégénérescence préclinique, ouvrant ainsi une démarche préventive pour la MA chez la population âgée à risque.
A MEDITER
Partagez votre expérience , l’humain avant tout , car la médecine est une aventure humaine unique.