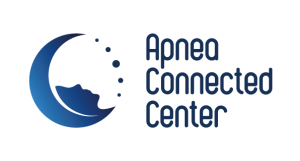#Apnée 3.0 : Quand deux #CPAP s’aiment d’#Amour… (ou pas)
Deux machines qui respirent nos nuits
Ils dorment côté à côte, masqués, reliés à des gestes mécaniques —
plastique translucide, velcro qui grince, tuyaux comme des racines d’oubli.
La chambre s’est convertie en petit poste de régulation atmosphérique :
deux écrans bleus, deux chiffres qui clignotent, deux courbes qui racontent des vies.
Autrefois on partageait des secrets dans l’obscurité, maintenant on partage des mises à jour.
« Nouvelle version du firmware disponible. Voulez‑vous redémarrer ? »
On rit jaune, on répond non avec la même politesse qu’on réserve aux ex.
Le souffle se synchronise sur des algorithmes ; la tendresse se mesure en ml/min.
Toi tu as l’air d’un astronaute domestique, et moi d’un patient dans une pièce d’hôpital réinventée.
On se parle en chiffres — 6 h 12, AHI 2, compliance 87 % — et comme ça on s’aime un peu,
avec la froide sécurité d’un rapport trimestriel. Le matin, on compare nos scores comme on comparerait des points de fidélité.
« Bravo, tu as battu ton record hier soir. » « Et toi, tu as enfin passé la nuit sans fuite. »
L’orgueil est devenu administratif.
La technologie a pris la place des caresses : elle ventile ce que nous ne savons plus offrir.
Elle nous donne de l’air, oui, mais à quel prix ? Le filtre est propre, la pression ajustée, et pourtant nos mains se cherchent dans le noir.
Les tuyaux font des arabesques sur la couverture, construisent des frontières : zone amoureuse, zone technique, zone neutre.
Nos corps se contorsionnent pour éviter de se débrancher mutuellement ; on invente des chorégraphies de précaution.
On se dispute pour la moindre statistique — douce jalousie numérique.
« Pourquoi ton appli me reporte plus de temps en REM ? »
« Parce que ton ronflement a un meilleur marketing. »
Les accusations tournent autour d’un écran et d’un mode d’emploi.
Le romantisme se retire, remplacé par un manuel d’utilisation.
Faire l’amour demande désormais un protocole.
Plan A : retirer les masques centralement, synchroniser les batteries de réserve, prévoir un temps mort pour la réinitialisation des machines.
Plan B : si l’amour se fait inattendu, il faut improviser : angles, tuyaux rétractés, promesse de nettoyer après.
On a transformé l’étreinte en logistique, le désir en checklist, la nuit en mode avion pour ne pas déclencher d’alarmes.
Et puis il y a la nuit où l’un se réveille, paniqué, le tuyau desserré, le masque en désaccord avec le visage.
« C’est la panne, appelle le technicien », dit‑on, en expirant comme si c’était un verdict.
On réalise à cet instant que la machine tient quelque chose de notre survie : fragile, indispensable, humiliant.
On s’aime moins, on respire plus — étrange consolation.
Les voisins s’entraînent à la discrétion, mais les appareils ont une esthétique sonore : un bourdonnement qui rêve d’être musique.
Parfois, dans un matin clair, on rit ; l’absurde nous fait grâce : deux adultes dignes, deux respirateurs personnels, deux êtres qui s’accordent pour réinventer la tendresse.
D’autres matins, la technologie devient témoin gêné de toutes nos petites mesquineries : menus non lus, mots d’amour laissés en brouillon.
On se dit des mots doux en langage d’ingénieur : « Ajuste ta pression, je ne suis pas un compresseur. »
On devient complice et ennemi : jaloux des chiffres, amoureux des courbes, haineux des alarmes.
La machine a des caprices ; elle réclame filtres, pièces, attention. Elle nous enseigne la maintenance du lien : un filtre propre, un tuyau sans pli, un masque bien ajusté.
Dans les pires nuits, on se ment à demi : « Ça va, je me suis habitué. » « Oui moi aussi. »
Mais on sait que la vérité se lit quand l’écran s’éteint : la main cherche, le bras s’attarde, la distance se mesure en centimètres de tuyau.
La réconciliation arrive souvent dans la petite mécanique du quotidien : un masque nettoyé, un filtre changé, une batterie chargée.
La tendresse devient une maintenance et, curieusement, ça marche.
Il y a une beauté clinique, froide et réelle, dans ce quotidien : deux machines qui protègent deux personnes qui s’aiment mal et bien.
C’est une sorte de promesse modernisée — pas de grande poésie, plutôt des engagements en plastique.
On survit, on rêve, on respire. Les CPAP prennent la place des vieux dieux du foyer ; elles veillent, implacables et fidèles.
Et quand enfin la nuit devient légère, quand les chiffres sont cléments et les bips rares, on ose un geste.
Un doigt qui effleure un tuyau, une main qui glisse pour toucher un visage masqué.
Le geste est humble ; il n’a rien d’érotique, tout est réparateur.
On n’a plus la force des grandes déclarations, seulement la grâce de petits soins partagés.
Alors on dort, deux machines qui respirent nos nuits, deux humains qui apprennent la patience.
On se réveille, échange un sourire timide et un café tiède, on regarde nos écrans comme on lirait la météo d’un avenir incertain.
On parle de filtres, on parle d’horaires, on parle aussi, parfois, d’amour sans relief ; c’est moins glamour, mais ça tient debout.
Au fond, la PPC est cette troisième présence qui met fin au spectacle de nos ronflements et qui, paradoxalement, nous rend plus vulnérables.
Elle nous oblige à accepter qu’aimer, ce n’est pas toujours être poète — parfois c’est juste savoir changer un filtre et appuyer sur « reset ».
Et c’est déjà beaucoup.